Tout de suite, je sens venir le torrent de reproches, voire d’imprécations. Comment puis-je être pour le nucléaire ?
Je vais exposer un certain nombre d’arguments :
Il est probablement vain de croire que la consommation d’énergie va baisser durant ce siècle. Le nombre d’êtres humains qui vont vouloir profiter des technologies « modernes » est considérable. Sans compter ceux qui vont naître et qui, à leur tour, seront demandeurs. Si l’on ne parvient pas à limiter la population de la terre, et l’on n’est pas parti pour, il sera quasi impossible de maîtriser l’augmentation de la demande d’énergie.
Faute de nucléaire, il faudra donc revenir, pour une part au moins, à des productions traditionnelles, à partir de pétrole, gaz ou charbon. Ces productions génèrent beaucoup de gaz carbonique. Il faudra donc en limiter l’emploi. Sans compter la question de l’épuisement des ressources.
Faute de solutions rapidement alternatives, on devra donc limiter la production de CO2. L’énergie deviendra alors rare et très chère en même temps que la demande augmentera. Cette solution n’étant économiquement et politiquement pas tenable, il n’y a donc pas grand-chose à espérer de ce côté.
Face à cette situation, l’énergie nucléaire est donc « propre », au moins en tant qu’elle ne produit pas de CO2. Elle cesse d’être propre en cas d’accident et au moment du démantèlement. Ces questions peuvent être résolues en faisant le contraire de ce qui se passe actuellement : la production d’énergie nucléaire ne peut être confiée à des opérateurs pour lesquels la recherche de bénéfices est la seule motivation. Le risque nucléaire sera amoindri, sinon anéanti, entre les mains d’organismes contrôlés et certifiés pas des autorités indépendantes, donc probablement nationalisés.
L’expérience doit maintenant permettre de produire de l’énergie nucléaire sans accident. On devrait être admiratif devant la sécurité des systèmes. Seul Tchernobyl a une cause endogène. Fukushima sans tsunami ne serait pas survenu. De toute façon, rien n’est sans risque : on ne doit pas oublier les catastrophes produites par des ruptures de barrages hydrauliques, par exemple.
Le démantèlement peut être anticipé, amélioré, grâce aux connaissances acquises. On peut imaginer des centrales souterraines dont l’enfouissement après décontamination de tout ce qui peut l’être, sera facile.
Rien n’interdit non plus d’imaginer que la recherche puisse faire découvrir comment neutraliser l’émission de radiations.
Produite dans des conditions de sécurité et de démantèlement ainsi définie, l’énergie nucléaire sera de toute façon chère. Mais elle ne produira pas de CO2. C’est cet dernier avantage qui surclasse les centrales au gaz, pétrole et charbon.
De toute façon, il y aura toujours des pays qui choisiront le nucléaire pour des raisons économiques. De façon pragmatique, il sera plus important d’assister ces pays sur les questions de sécurité que de mettre en cause, de façon onéreuse, sa propre production. Autant tourner les crédits correspondants vers la sécurité à l’échelle mondiale.
Tout ceci dans une période de transition vers des énergies alternatives dont la durée risque d’être très longue, car il est totalement impossible de prévoir quand ces énergies seront disponibles et assez puissantes pour couvrir tous les besoins. Et c’est seulement à ce moment là, qu’on pourra, peut-être, sortir du nucléaire.
Les énergies alternatives seront elles-mêmes génératrices d’inconvénients qu’on ne peut prévoir. Quid d’une écorce terrestre qui serait privée d’une partie notable de son ensoleillement intercepté par des panneaux de cellules photovoltaïques ? Ou qui serait refroidie par une géothermie intense ? Quid de l’effet sur le climat par des modifications de vents capturés par des milliers d’éoliennes ? …
Il y a enfin la complexité et le coût économique et écologique du stockage dans des batteries contenant des composants eux-mêmes polluants.
Décider aujourd’hui de sortir du nucléaire ou d’y renoncer sans visibilité sur les solutions techniques, dans un environnement demandeur, est donc une fausse bonne solution. Si ce n’est pas une totale ânerie.
Il existe, cependant, une authentique bonne solution. Elle consiste à bloquer, voire faire diminuer la population terrestre. De toute façon, il y aura un moment où cela deviendra inévitable. Au rythme actuel, il y aura 40 milliards de terriens en 2100 ! 300 milliards un siècle plus tard ! Ce problème est largement plus complexe et plus déterminant que la question de sortir ou non du nucléaire.
On ferait bien de s’en préoccuper.
Consulter:
http://dufoyer.fr/wp-content/uploads/2008/05/27/la-population-de-la-terre-il-y-a-un-probleme/
http://www.populationmondiale.com/
Notes d’économie politique 56 – 15 juin 2011

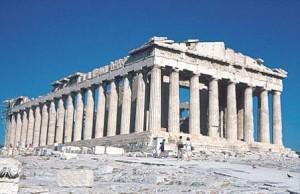


 it falsifié des rapports constatant des fissures ou des corrosions. L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique, avait indiqué en 2009 que les réacteurs de Fukushima ne pourraient résister à des séismes d’un degré supérieur à 7. Enfin, le 28 février 2011, soit 13 jours avant l’accident, la société TEPCO, indique à l’Agence Japonaise de Sûreté Nucléaire n’avoir pas contrôlé 33 éléments des six réacteurs de Fukushima-Daiichi (
it falsifié des rapports constatant des fissures ou des corrosions. L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique, avait indiqué en 2009 que les réacteurs de Fukushima ne pourraient résister à des séismes d’un degré supérieur à 7. Enfin, le 28 février 2011, soit 13 jours avant l’accident, la société TEPCO, indique à l’Agence Japonaise de Sûreté Nucléaire n’avoir pas contrôlé 33 éléments des six réacteurs de Fukushima-Daiichi ( On disposait donc de toutes les données historiques pour la construction et la protection de ces centrales : magnitude possible de 8,5, tsunami de 38 mètres. Toute la question est alors : une société nationale aurait-elle pris de tels risques. La réponse n’est assurément pas « non », mais il est évident que l’espérance de profit a contribué à construire une centrale dans un lieu potentiellement dangereux, d’autant plus qu’on sait que les accidents sont principalement liés au tsunami. Il aurait donc suffi de construire cette centrale à une altitude 50 mètres pour que la catastrophe n’arrive pas !
On disposait donc de toutes les données historiques pour la construction et la protection de ces centrales : magnitude possible de 8,5, tsunami de 38 mètres. Toute la question est alors : une société nationale aurait-elle pris de tels risques. La réponse n’est assurément pas « non », mais il est évident que l’espérance de profit a contribué à construire une centrale dans un lieu potentiellement dangereux, d’autant plus qu’on sait que les accidents sont principalement liés au tsunami. Il aurait donc suffi de construire cette centrale à une altitude 50 mètres pour que la catastrophe n’arrive pas ! L’enseignement de ces évènements est donc bien qu’on minimisera les risques lorsque l’espérance de profit n’est pas le moteur premier de la construction et de l’exploitation. Seules des entreprises nationales peuvent apporter garantie, quoique relative, de sécurité. L’exemple des accidents mortels des transports ferroviaires britanniques après privatisation.
L’enseignement de ces évènements est donc bien qu’on minimisera les risques lorsque l’espérance de profit n’est pas le moteur premier de la construction et de l’exploitation. Seules des entreprises nationales peuvent apporter garantie, quoique relative, de sécurité. L’exemple des accidents mortels des transports ferroviaires britanniques après privatisation. Concernant le premier point, on a vu apparaître des installateurs peu qualifiés se précipitant sur l’effet d’aubaine pour faire signer des contrats par les particuliers. Des organismes de crédit se sont impliqués dans la partie et l’on faisait croire que les déductions fiscales et le prix de rachat du kilowatt compenseraient largement les mensualités, ce qui dépend du prix de rachat qui n’est nullement garanti. De plus, la qualité des panneaux et la compétence des installateurs n’étant nullement certifiés, on se trouve déjà devant de nombreux recours, sans compter le nombre de citoyens bernés qui n’oseront déposer plainte à cause d’installations de mauvaise qualité. Aux jours d’aujourd’hui encore, on démarche des clients par téléphone sur la base de données fiscales et d’un prix de rachat dont on sait pertinemment qu’ils vont être modifiés sous peu.
Concernant le premier point, on a vu apparaître des installateurs peu qualifiés se précipitant sur l’effet d’aubaine pour faire signer des contrats par les particuliers. Des organismes de crédit se sont impliqués dans la partie et l’on faisait croire que les déductions fiscales et le prix de rachat du kilowatt compenseraient largement les mensualités, ce qui dépend du prix de rachat qui n’est nullement garanti. De plus, la qualité des panneaux et la compétence des installateurs n’étant nullement certifiés, on se trouve déjà devant de nombreux recours, sans compter le nombre de citoyens bernés qui n’oseront déposer plainte à cause d’installations de mauvaise qualité. Aux jours d’aujourd’hui encore, on démarche des clients par téléphone sur la base de données fiscales et d’un prix de rachat dont on sait pertinemment qu’ils vont être modifiés sous peu.