Au moment où la Ministre est en train de peaufiner un projet de décret destiné à punir les enseignants de l’Université qui se trouveraient être de « piètres chercheurs », il n’est peut-être pas inutile de faire connaître au public, ce qu’est un travail de recherche.
Quand on présente, à la télévision, des images censées illustrer l’activité de recherche, on montre volontiers des personnes en blouse blanche devant des paillasses et des tubes à essais. Mais, dans la réalité, l’activité prend des formes très diverses et recouvre différentes phases préparatoires, qui prennent souvent bien plus de temps que la « paillasse » proprement dite. Si les biologistes cherchent dans des « laboratoires », il faut aussi se demander où sont les archéologues , les paléontologues, les mathématiciens, les psychologues, les astronomes, etc. ?
Car la recherche se fait d’abord avec la pensée. Chercher, c’est formuler des questions, nous disons des hypothèses, c’est mettre en œuvre des moyens de vérifier ou d’infirmer ces hypothèses et apprendre de ce travail suffisamment pour continuer, en reformulant d’autres questions dont on essaiera de faire la preuve, etc.. Tout ce qui se passe avant le moindre geste spécialisé dans le cerveau du chercheur, ou, de plus en plus souvent, dans les cerveaux des membres de l’équipe de recherche, fait partie de ce travail et peut être long. Car une hypothèse, et la réunion de tous les éléments nécessaires à son examen, ne s’improvisent pas.
Une hypothèse est le fruit d’observations, d’expériences et de connaissances étendues. Il serait naturellement vain et ridicule de réinventer ce qu’on sait déjà. Le chercheur est censé connaître TOUT ce qui a déjà été fait ou dit sur le sujet qui l’intéresse. Et s’il est vrai que les moyens informatiques permettent aujourd’hui de trouver plus facilement les ouvrages et les articles nécessaires à sa réflexion, la prolifération de ces derniers, due à une pression aggravée sur les chercheurs pour qu’ils publient beaucoup, fait contrepoids. Se documenter sur un sujet peut prendre des semaines, des mois ! Et comme les publications paraissent sans cesse, ce travail de documentation, ou « veille scientifique », n’est jamais véritablement terminé.
Parallèlement, il faut mettre en place la méthode, le protocole comme on dit souvent, qui pourra permettre d’avancer, en général, par petits pas, pour valider ou invalider l’hypothèse de départ. Et il faut savoir qu’il est alors fréquent de s’apercevoir que cette hypothèse a besoin d’être remaniée, et que le protocole devra être modifié, lui aussi, au vu d’aléas qui ne sont pas tous prévisibles, et ce d’autant plus que la problématique est nouvelle…Car il est impossible de reproduire en laboratoire les conditions du terrain, impossible de mettre en place sur le terrain tous les éléments souhaités, et plus généralement, difficile ou impossible de prévoir ou d’effectuer tous les contrôles nécessaires…. La recherche est faite de compromis entre les vœux sophistiqués et rigoureux du chercheur et une réalité incontournable. C’est là qu’il doit être capable d’inférer les conséquences sur ses résultats de l’ensemble des éléments qu’il n’a pu maîtriser et c’est pourquoi le chercheur s’exprime toujours en termes de probabilités.
Il ne faut pas croire non plus, que les astronomes passent leurs nuits à promener leurs télescopes, au hasard. Une observation céleste aura fait l’objet d’une longue préparation pour déterminer la probabilité d’une découverte. Il ne faut pas croire que les historiens se jettent sur les grimoires de la Bibliothèque Nationale sans une préparation soigneuse. Il ne faut pas croire que les archéologues se mettent à faire des trous dans le sol au hasard. Il ne faut pas croire que les psychologues interrogent les passants dans la rue en leur posant des questions jetées sur le papier une heure avant. Et que dire des expériences de physique nucléaire, de modélisation informatique, de biologie médicale, etc. !
Faire de la recherche demande du temps. Du temps pour réfléchir et préparer les bonnes questions, du temps pour réfléchir et préparer les bon dispositifs d’investigation, et du temps, parfois beaucoup de temps pour comprendre les résultats qui n’ont pas l’habitude d’être forcément ceux qu’on attend. Et, ne pas vérifier une hypothèse pose au moins autant de questions que sa vérification.
Voilà rapidement dressé le tableau schématique de l’activité de recherche proprement dite. Mais un chercheur doit aussi communiquer avec la communauté scientifique. Il doit présenter ses recherches dans des congrès, publier des articles, voire des livres. Il lui faut donc écrire. Et l’on imagine volontiers qu’écrire un article, avec toutes les règles très strictes et très codifiées inhérentes à la science, n’est pas chose facile. On ne s’assied pas devant son traitement de texte en se disant « tiens, je vais pondre un article ce matin ». Il faut décrire avec la plus grande minutie ce qui a été fait. Il existe une règle : une recherche doit pouvoir être reproduite et par conséquent les résultats retrouvés à partir des seules informations présentées dans l’article. Il faut aussi discuter, commenter, mettre en perspective les résultats et référencer tous les travaux déjà publiés dans le domaine.
Mais voici qu’on demande maintenant au chercheur d’effectuer des tâches qui n’ont plus rien à voir avec la recherche proprement dite. Aujourd’hui, il lui faut écrire des contrats de recherche ! On se met même à juger de sa créativité en fonction du nombre de contrats obtenus ! Il lui faut donc aussi être un bon vendeur ! Savoir tourner son texte pour faire miroiter les « merveilleuses » retombées économiques de son travail !
De qui se moque-t-on ? Edison aurait-il prédit ….. ? Pasteur aurait-il prédit ….. ?
Qui est le partenaire privilégié du chercheur ? Le service de communication de son institut, formé à la publicité et à la vente ? Ou d’autres passionnés comme lui, prêt à s’investir pour comprendre un phénomène ? Doit-il rechercher la rentabilité à court terme ou les découvertes à long terme ?
Et il y a aussi une chose qu’on oublie trop souvent. Un chercheur ne commence pas à chercher en entrant dans son bureau à 9 heures et ne cesse pas à 18 heures. Un chercheur ne peut même pas véritablement se mettre en grève, car il faudrait qu’il s’arrête de penser ! Un chercheur cherche en des lieux inattendus, en des circonstances qu’on pourrait croire improbables. Un chercheur peut réfléchir à ses travaux dans son lit, dans son bain, sur un télésiège, dans le métro et dans mille autres lieux et circonstances pour peu qu’il ait le loisir de permettre à sa pensée… de penser. Un enseignant de l’Université est censé avoir une telle activité à mi-temps. Les décrets prévus par notre ministre précisent même le nombre d’heures exactement ! On voit bien que ce partage est tout à fait théorique. Selon les moments, selon l’expérience en cours, il en sera ceci ou cela.
Mais, non content de produire des textes de haut niveau, il est aussi encouragé, souvent par lui-même qui en ressent le besoin, à écrire des manuels ou des ouvrages introductifs pour les étudiants. Ces ouvrages sont complexes, car il faut toujours négocier entre le côté pédagogique et le côté scientifique, sans tomber dans la simplification ou la schématisation trop fortes. Et qu’on ne fasse pas « le coup » des droits d’auteurs. Vu la taille des tirages, ils sont souvent symboliques !
Si l’on ajoute à cela, la durée des cours et leur préparation (car on n’a pas toujours la possibilité, surtout en premier cycle, de produire des enseignements autour de ses propres thèmes de recherche), les tâches annexes d’examen, de corrections (à une époque où la demande de contrôle continu est très forte), de jurys, de direction de mémoires ou de thèses, d’innovation pédagogique (qui est malheureusement souvent le parent pauvre, faute de temps), de tutorat (pour les étudiants mais également les chargés de cours), de participation aux Conseils de gestion ou d’administration et les activités d’organisation pédagogique, et ceci pour un salaire correspondant à celui d’un cadre petit ou moyen dans le secteur privé, on commence à se faire une idée plus précise de l’ampleur de la tâche.
Que peut-il arriver, alors, si un chercheur, accaparé par ces tâches multiples, n’a plus de contact renouvelé et soutenu avec la littérature ? Le risque essentiel, c’est qu’il perde sa créativité et qu’il ne puisse plus formuler d’hypothèses innovantes, car celles-ci proviennent directement de la confrontation des savoirs et des idées. Pourquoi pensez-vous que les jeunes apparaissent plus créatifs que les « vieux », est-ce parce qu’ils sont plus intelligents, plus réfléchis ? Non, la vérité se trouve plutôt dans le fait qu’ils n’ont plus le temps ! Temps de lire, temps de s’interroger, temps de confronter, temps d’exercer leur pensée critique ! Le propre d’un chercheur est de se poser encore des questions là où d’autres se contenteront de réponses bien établies.
Faut-il vraiment ajouter qu’un chercheur ne peut qu’être très consciencieux. la qualité d’une recherche, et le fait que ses résultats « tiendront » ou non avec le temps, est directement proportionnel à la rigueur avec laquelle elle a été menée. Le quotidien du chercheur est fait de minutie et de contrôle, ce qui s’envisage mal lorsqu’il s’agit de grappiller par ci par là des minutes entre des dizaines d’autres activités.
Enfin, dans un autre registre, on ajoutera que, dans certains secteurs, il est souhaitable d’avoir une pratique professionnelle. Imagine-t-on des enseignants en médecine qui ne pratiquent pas, des psychologues qui n’ont pas de clients ? Il est même souhaitable que, d’une certaine façon, les enseignants de l’Université aient une certaine expérience du monde du travail auquel ils préparent les étudiants. On leur reproche assez, et parfois à tort, de n’en point avoir.
Alors, de grâce, laissons-les en paix en n’oubliant pas qu’aucune loi n’empêchera leur cerveau de travailler le dimanche.
Jean Pierre Dufoyer
Carolyn Granier-Deferre
Maîtres de Conférence
Université Paris Descartes
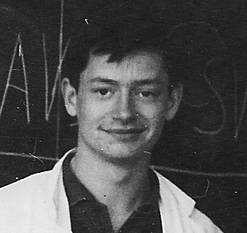 Je recherche, avec d’autres, des photos, des gens qui auraient été élèves de la classe de Sciences Experimentales au Lycée de Montgeron en 1961-1962
Je recherche, avec d’autres, des photos, des gens qui auraient été élèves de la classe de Sciences Experimentales au Lycée de Montgeron en 1961-1962 Ce matin, j’entends François Chéreque à la radio. Il n’a pas perdu son accent lamentable et dépressif. D’ailleurs, il donne vraiment dans le dépressif. C’est la « crise ». Alors il se lamente. Il se lamente sur le sort des travailleurs réduits au chômage technique. Il se lamente sur le fait que le RSA ne sera mis en oeuvre qu’au 1er juillet. Il se lamente en disant « qu’il faudrait bien » que les revenus des salariés, et patati, et que les patrons, et patata…
Ce matin, j’entends François Chéreque à la radio. Il n’a pas perdu son accent lamentable et dépressif. D’ailleurs, il donne vraiment dans le dépressif. C’est la « crise ». Alors il se lamente. Il se lamente sur le sort des travailleurs réduits au chômage technique. Il se lamente sur le fait que le RSA ne sera mis en oeuvre qu’au 1er juillet. Il se lamente en disant « qu’il faudrait bien » que les revenus des salariés, et patati, et que les patrons, et patata…