Le libéralisme a montré ses limites et ses dangers.
Pendant de nombreuses années, en France, des pans entiers de la production industrielle ont appartenu à l’état. Le secteur de l’énergie est emblématique de cette situation: Charbonnages de France, Gaz de France, Electricité de France. Cette position découlait, notamment après la seconde guerre mondiale d’une volonté stratégique. Qui contrôle ces domaines se trouve dans une bonne situation stratégique en cas de conflit.
D’autres domaines, pour des raisons comparables, ont été maintenues dans le giron de l’état: sont bien connus les cas des Chemins de Fer, la distribution du courrier, les télécommunications. D’autres le sont moins, comme la construction aéronautique (S.N.C.A.S.O. et S.N.C.A.S.E. fusionnant pour devenir, avec d’autres fusions la S.N.I.A.S. puis l’Aerospatiale). Aujourd’hui, alors que tout celà est devenu E.A.D.S. à force de fusions, ventes et prises de participations diverses nationales et internationales, l’état français détient encore directement et indirectement des parts dela construction aéronautique française. Sa participation vient d’ailleurs d’être augmentée, par le truchement de la Caisse des Dépôts au moment de la revente des parts et stock-options de plusieurs dirigeants et cadres (environ 1200) à un moment où le délit d’initié est probablement constitué.
La période de crise des années 70-80 conduit la sidérurgie française à des concentrations successives, qui s’organisent autour de 2 pôles : Usinor et Sacilor. En 1981, l’Etat français prend la majorité du capital des deux sociétés. L’Etat décide de réaliser leur fusion en 1986 pour en améliorer la performance : Usinor Sacilor est né. En juillet 1995 Usinor Sacilor est à nouveau privatisé. Le groupe prend le nom d’Usinor en juin 1997.
 D’autres secteurs qe la production industrielle se sont trouvés dans le giron de l’état. En 1945 le gouvernement du Général de Gaulle a nationalisé la Banque de France et les quatre premières banques commerciales disposant d’un réseau national : Crédit lyonnais, Société générale, Comptoir national d’escompte de Paris et BNCI. L’État a pris en main l’essentiel du crédit. Pendant une vingtaine d’années, les banques nationalisées se sont consacrées à la collecte de l’épargne à court terme, elles ont soutenu les émissions du Trésor tout en participant au financement de la reconstruction et de la modernisation de l’économie. Les banques nationalisées constituaient un secteur stratégique pour l’économie nationale, où on évitait de se faire concurrence.
D’autres secteurs qe la production industrielle se sont trouvés dans le giron de l’état. En 1945 le gouvernement du Général de Gaulle a nationalisé la Banque de France et les quatre premières banques commerciales disposant d’un réseau national : Crédit lyonnais, Société générale, Comptoir national d’escompte de Paris et BNCI. L’État a pris en main l’essentiel du crédit. Pendant une vingtaine d’années, les banques nationalisées se sont consacrées à la collecte de l’épargne à court terme, elles ont soutenu les émissions du Trésor tout en participant au financement de la reconstruction et de la modernisation de l’économie. Les banques nationalisées constituaient un secteur stratégique pour l’économie nationale, où on évitait de se faire concurrence.
D’un autre côté, c’est le Trésor qui a financé principalement la réalisation des premiers Plans et c’est la Caisse des dépôts qui a aidé les collectivités locales et financé la construction des logements populaires. Par contre, les banques « d’affaires » qui n’ont pas fait l’objet d’une nationalisation ont continué leur activité dans le développement des investissements industriels et financiers. Ce n’est qu’en 1987 que le processus de privatisation des banques de dépôt a commencé. Vingt ans après, il est à peu près terminé.
Pendant longtemps, en France, des entreprises qu’on croyaient privées appartenaient en tout ou partie à l’état. Il fallait être bien informé pour savoir que la radio Europe N°1 n’était pas une radio « libre ». Un certain Charles Michelson qui avait obtenu avant guerre une concession de radio à Tanger s’était fait donner le monopole de la radiodiffusion en Sarre en 1952 (à cette époque, la Sarre avait un statut particulier: province allemande, elle était cependant administrée par la France). Ainsi naquit Europe 1, station de radio de langue française échappant au monopole de l’état français, situation comparable à celle de Radio Luxembourg qui émettait depuis le territoire luxembourgeois. Puis la radio de M. Michelson fit faillite en 1955. A la demande du gouvernement français, Sylvain Floirat (un industriel exploitant des lignes aériennes sous convention de transport public) la reprit. Il en devint propriétaire en 1956. Puis, en 1959, l’état prit le contrôle d’une partie du capital par l’intermédiaire de la Sofirad (Société Financière de Radio-diffusion dont l’état était propriétaire et qui gèrait les participations de ce dernier dans les stations de radio et de télévision). C’est en raison de la puissance de l’état, qu’après 1968, et compte tenu du comportement de l’antenne pendant les évènements, la direction d’Europe 1 fut poussée vers la sortie. C’est alors qu’apparût Jean Luc Lagardère dans le capital. Mais sous la présidence de François Mitterand, l’état avait encore son mot à dire dans les choix éditoriaux. Ce n’est qu’en 1986, lorsque l’état vendit à Hachette (Lagardère) sa participation, que la chaîne devint entièrement privatisée.
Le cas d’Europe 1 n’est pas isolé. Pendant de nombreuses années l’état français a détenu, par exemple, jusqu’à 86% de Radio Monte Carlo par l’intermédiaire de la Sofirad.
C’est ainsi que, pendant de nombreuses années, l’état a investi, soit directement, soit indirectement, de façon importante dans l’économie. Ceci a probablement atteint un sommet en France après l’arrivée au pouvoir de la gauche en 1981. Puis la tendance s’est inversée, y compris sous des gouvernements de gauche. Cette inversion motivée, pour une bonne part par des directives de la Communauté Européenne, l’a été aussi pour des raisons idéologiques. La gauche social-démocrate a fait sienne la notion d’économie de marché et de libre entreprise et, corrélativement, accepté la baisse du pouvoir régalien de l’état, a l’opposé de la gauche communiste ou révolutionnaire.
Pour une part, la notion de nationalisation repose sur la nécessité de contrôle stratégique de certaines activités économiques ou industrielles, en cas de conflit militaire. S’y retrouvent naturellement la production d’énergie, les télécommunications, les transports, etc., liste dans laquelle on retrouve les thèmes de grandes nationalisations de l’après-guerre. Peuvent s’y ajouter la métallurgie et certaines productions qui en dépendent comme les usines d’armement, la construction navale, aéronautique, routière dans les arsenaux ou de grandes usines d’état (Renault, par exemple).
 Au delà de la notion de contrôle stratégique en cas de conflit, le maintien dans le giron de l’état de certaines activités économiques répond aussi à la nécessité de « Service Public ». La notion de service public s’entend alors au sens de service destiné au public et donc à tout citoyen, quelle que soit sa position ou sa situation. S’y attache, en plus, une notion républicaine d’égalité de droit. Ainsi, dans cette optique, tout citoyen doit pouvoir, par exemple, disposer de l’énergie électrique à son domicile. Et sans qu’il lui en coûte plus qu’aux autres citoyens même s’il habite dans un lieu très retiré. Ceci implique qu’on installe pour son seul usage, à grands frais évidemment, des kilomètres de ligne. Dans les premiers temps, il en fut bien ainsi. Puis peu à peu, E.D.F. a demandé des contributions pour l’approvisionnement de demeures lointaines, ce qui contrevint à cette logique républicaine d’égalité de droits entre tous les citoyens.
Au delà de la notion de contrôle stratégique en cas de conflit, le maintien dans le giron de l’état de certaines activités économiques répond aussi à la nécessité de « Service Public ». La notion de service public s’entend alors au sens de service destiné au public et donc à tout citoyen, quelle que soit sa position ou sa situation. S’y attache, en plus, une notion républicaine d’égalité de droit. Ainsi, dans cette optique, tout citoyen doit pouvoir, par exemple, disposer de l’énergie électrique à son domicile. Et sans qu’il lui en coûte plus qu’aux autres citoyens même s’il habite dans un lieu très retiré. Ceci implique qu’on installe pour son seul usage, à grands frais évidemment, des kilomètres de ligne. Dans les premiers temps, il en fut bien ainsi. Puis peu à peu, E.D.F. a demandé des contributions pour l’approvisionnement de demeures lointaines, ce qui contrevint à cette logique républicaine d’égalité de droits entre tous les citoyens.
La nationalisation peut être considérée aussi comme un élément de sécurité. Est-il raisonnable de permettre à des sociétés qui recherchent le profit de s’adonner à des activités dangereuses. On peut craindre que le désir de faire des bénéfices l’emporte sur la sécurité. C’est vrai pour divers domaines très sensibles comme la production d’électricité nucléaire, mais aussi pour le transport aérien ou ferroviaire, comme l’entretien des routes et autoroutes. C’est ainsi que, contrairement à ce que l’on croit, un biographe de Margaret Thatcher affirme qu’elle n’était pas partisane de la privatisation de British Rail. C’est d’ailleurs son successeur qui la fit.
La nationalisation peut être vue aussi, comme une façon de maîtriser les coûts. Ce débat a toujours animé les Conseils Municipaux à propos, par exemple, de l’attribution du marché de l’eau potable. On constate, en général, que le coût du mètre cube d’eau potable peut-être très différent selon que la distribution est ou non assurée par une régie municipale. On remarque aussi que les bénéfices des sociétés concessionnaires de service public versent des dividendes à leurs actionnaires qui sont plus élevés que ce qui est raisonnable dans un environnement industriel qui n’est évidemment pas spéculatif. Le recours à des sociétés privées pour des marchés aussi importants que la distribution de l’eau potable ou l’enlèvement des ordure ménagères font disparaître aussi, pour une bonne part les risques de corruption. En tout état de cause, un établissement industriel ou commercial qui n’a pas à verser de dividendes devrait avoir, à contraintes et objectifs comparables, des coûts de gestion moins importants.
On a parfois montré du doigt les moins bonnes performances de la gestion directe, au motif d’un manque de technicité ou d’un manque de productivité des agents. mais c’est confondre les choses. Rien n’empêche une collectivité de recruter des cadres compétents et de les motiver d’une façon convenable. Et il arrive bien souvent que l’ingérence des politiques à qui il arrive souvent de ne pas se comporter en bon gestionnaires utilisant la chose publique comme leur chose personnel à des fins électoralistes ou clientèlistes.
 Une analyse simpliste conduit souvent à faire croire que la productivité d’une gestion nationalisée est inférieure à celle d’une gestion. Divers exemples montrent le contraire. On ignore souvent que c’est grâce à la recherche, en partenariat avec l’Ecole Nationale des Télécommunications que France Télécom a mis la France en état de passer vite et bien à l’ére numérique. C’est autant grâce à la SNCF qu’à Alsthom que fut créé le TGV, produit industriel modèle et exportable. On ignore souvent que la RATP dispose d’une société qui est intervenue dans la mise en oeuvre de divers métros de par le monde. Et peut-on considérer comme une réussite que tout ce qui reste dans la métallurgie française soit passé entre les mains de la Mittal Steel Company ? Et le coût social du démantèlement de celle-ci en France est-il moins ou plus élevé que les aides qu’on aurait pu apporter à ces industries pour qu’elles subsistent ? Lorsque les autoroutes, en France, ont été construites grâce au péage payés par les usagers, les gouvernants avaient promis qu’une fois amorties, celles-ci reviendraient dans le domaine public. Mensonges: elles ont été vendues. Seul le pont de l’Ile d’Oléron, construit par le département de la Charente Maritime, est devenu gratuit en 1991 une fois amorti.
Une analyse simpliste conduit souvent à faire croire que la productivité d’une gestion nationalisée est inférieure à celle d’une gestion. Divers exemples montrent le contraire. On ignore souvent que c’est grâce à la recherche, en partenariat avec l’Ecole Nationale des Télécommunications que France Télécom a mis la France en état de passer vite et bien à l’ére numérique. C’est autant grâce à la SNCF qu’à Alsthom que fut créé le TGV, produit industriel modèle et exportable. On ignore souvent que la RATP dispose d’une société qui est intervenue dans la mise en oeuvre de divers métros de par le monde. Et peut-on considérer comme une réussite que tout ce qui reste dans la métallurgie française soit passé entre les mains de la Mittal Steel Company ? Et le coût social du démantèlement de celle-ci en France est-il moins ou plus élevé que les aides qu’on aurait pu apporter à ces industries pour qu’elles subsistent ? Lorsque les autoroutes, en France, ont été construites grâce au péage payés par les usagers, les gouvernants avaient promis qu’une fois amorties, celles-ci reviendraient dans le domaine public. Mensonges: elles ont été vendues. Seul le pont de l’Ile d’Oléron, construit par le département de la Charente Maritime, est devenu gratuit en 1991 une fois amorti.
Il n’y a aucune certitude que le privé fasse mieux que le public et réciproquement. Alors, pourquoi l’Etat n’investirait-il pas dans des activités économiques profitables pour que les retombées profitent aux citoyens ? Imaginons que les immenses bénéfices des banques devenues toutes privées abondent le Trésor Public, au lieu de tomber dans les poches de gros investisseurs ?
Au nom de l’Europe, l’économie est devenue totalement capitaliste et libérale. Le Parti Socialiste Français, s’y est converti, sans grande peine d’ailleurs. Et pendant ce temps, les riches, les consortiums, n’ont jamais fait autant de profits et ne se sont jamais tant enrichi sans cause. La pourcentage de ce profit est passé de 60% à 33% en 50 ans ! Le libéral-capitalisme avait montré ses sinistres effets dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Instruits de cette expérience, les politiques du XXème siècle l’avaient maintenu en liberté surveillée. Notamment à l’issue de la seconde guerre mondiale. En France, ce fut sous De Gaulle, qu’on ne peut targuer d’être marxiste que ceci se fit. Et ce n’est pas cette question qui provoqua son départ. Il existe d’ailleurs toujours une droite souverainiste qui partage, au moins sur ce sujet, quelques idées de la gauche. C’est la raison pour laquelle, le référendum sur la Constitution Européenne fut rejeté aussi bien par des électeurs de droite que de gauche. Car, il faut vraiment faire la politique de l’autruche pour croire que l’Europe, tenue par des puissantes forces libérales, ne continuera pas dans cette mauvaise voie.
C’est d’ailleurs désolant, de constater comment l’idéal des créateurs de l’idée européenne qui était, au premier chef d’éviter le renouvellement des conflits, et au deuxième de créer un grand pays socialement et économiquement solidaire, se vautre maintenant dans la vase de la concurrence sauvage et inhumaine. Et ce mouvement est tellement fortement lancé qu’on s’achemine inévitablement vers une Europe des banquiers et du grand capital. Il en découlera nécessairement, à un moment, de grandes difficultés sociales car le grand capitalisme est incapable de maîtriser son avidité. L’exemple récent d’un jeune trader jouant en bourse un montant équivalent au P.I.B. d’un pays comme le Maroc en est un témoignage. L’appel « prolétaire de tous les pays unissez-vous » a toujours un sens. Il est affreusement dommage que l’application du marxisme, hélas devenu marxisme-léninisme, ait sombré dans d’épouvantables sociétés dictatoriales qui n’avaient rien à envier au fanatisme nazie. Mais cette évolution est une question d’hommes et non de philosophie. Il se trouve qu’après chaque révolution le pouvoir du peuple lui échappe. Triste routine contre laquelle les esprits libertaires ont du mal à lutter.
Le retour à l’économie administrée est une voie moyenne vers la réalisation d’une grande ambition sociale. Elles ne passe pas forcément par la nationalisation pure et dure. Il existe toutes sortes de formes d’économie mixte qui laissent aux états le pouvoir d’agir dans de nombreux domaines et particulièrement dans ceux dont dépend la vie quotidienne des citoyens. Les états, ce sont les gouvernements, et les gouvernements sont composés d’hommes. L’électeur devra donc prendre garde à choisir des représentants ayant une grande morale politique. Contrairement à ce que l’on croit, ils existent. Ils existent d’ailleurs aussi bien à droite qu’à gauche.
Notes d’économie politique 12 – 10 février 2008
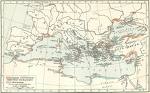

 Le modèle libéral de la concurrence sauvage vient de craquer une fois de plus : à force de vouloir être moins cher que son concurrent, voici que l’on vend à perte. Alors viennent, à leur tour, les appels à l’aide vers le budget fédéral et donc l’intervention des deniers du contribuable.
Le modèle libéral de la concurrence sauvage vient de craquer une fois de plus : à force de vouloir être moins cher que son concurrent, voici que l’on vend à perte. Alors viennent, à leur tour, les appels à l’aide vers le budget fédéral et donc l’intervention des deniers du contribuable. Qu’est-ce qui a provoqué cela ? Ce n’est pas difficile à comprendre. Le commerce international, dérégulé, voire corrompu ou corrupteur. Pourquoi ? Parce qu’il y trouve largement son compte en revendant au monde les produits africains et en vendant aux africains les produits transformés chez leurs anciens colonisateurs. Le Nigéria exporte du pétrole brut qu’il pourrait tout aussi bien raffiner sur place. Les pêcheurs du lac Victoria exportent la Perche du Nil en filets et se contentent des arêtes.
Qu’est-ce qui a provoqué cela ? Ce n’est pas difficile à comprendre. Le commerce international, dérégulé, voire corrompu ou corrupteur. Pourquoi ? Parce qu’il y trouve largement son compte en revendant au monde les produits africains et en vendant aux africains les produits transformés chez leurs anciens colonisateurs. Le Nigéria exporte du pétrole brut qu’il pourrait tout aussi bien raffiner sur place. Les pêcheurs du lac Victoria exportent la Perche du Nil en filets et se contentent des arêtes. J’ai découvert par hasard, dans la presse, qu’il y a quelques jours, une bonne partie des avions américains (j’entends des U.S.A.) avaient été et sont encore cloués au sol. La raison ? Fort simple. On a découvert que nombre d’entre eux présentaient certains défauts graves et des risques pour la sécurité des voyageurs.
J’ai découvert par hasard, dans la presse, qu’il y a quelques jours, une bonne partie des avions américains (j’entends des U.S.A.) avaient été et sont encore cloués au sol. La raison ? Fort simple. On a découvert que nombre d’entre eux présentaient certains défauts graves et des risques pour la sécurité des voyageurs. Dans un article paru dans Le Monde daté du 7 février 2008, Bertrand Bissuel et Laetitia Clavreul s’interrogent sur les raisons qui poussent Unilever à appliquer une cure d’austérité à l’usine Cogesal-Miko de Saint-Dizier (Haute-Marne) qui va se concrétiser par la suppression de 250 emplois sur 500. Cette usine a dégagé 222 millions d’euros de bénéfice en 2006 et les indications sur l’exercice 2007 sont encore très favorables. Plus généralement, les résultats d’Unilever annoncés en 2007 étaient très bons. En août 2007 on annonçait que les bénéfices, comparés à la période précédente, étaient alors en hausse de 16 %, à 1,207 milliard d’euros.
Dans un article paru dans Le Monde daté du 7 février 2008, Bertrand Bissuel et Laetitia Clavreul s’interrogent sur les raisons qui poussent Unilever à appliquer une cure d’austérité à l’usine Cogesal-Miko de Saint-Dizier (Haute-Marne) qui va se concrétiser par la suppression de 250 emplois sur 500. Cette usine a dégagé 222 millions d’euros de bénéfice en 2006 et les indications sur l’exercice 2007 sont encore très favorables. Plus généralement, les résultats d’Unilever annoncés en 2007 étaient très bons. En août 2007 on annonçait que les bénéfices, comparés à la période précédente, étaient alors en hausse de 16 %, à 1,207 milliard d’euros. D’autres secteurs qe la production industrielle se sont trouvés dans le giron de l’état. En 1945 le gouvernement du Général de Gaulle a nationalisé la Banque de France et les quatre premières banques commerciales disposant d’un réseau national : Crédit lyonnais, Société générale, Comptoir national d’escompte de Paris et BNCI. L’État a pris en main l’essentiel du crédit. Pendant une vingtaine d’années, les banques nationalisées se sont consacrées à la collecte de l’épargne à court terme, elles ont soutenu les émissions du Trésor tout en participant au financement de la reconstruction et de la modernisation de l’économie. Les banques nationalisées constituaient un secteur stratégique pour l’économie nationale, où on évitait de se faire concurrence.
D’autres secteurs qe la production industrielle se sont trouvés dans le giron de l’état. En 1945 le gouvernement du Général de Gaulle a nationalisé la Banque de France et les quatre premières banques commerciales disposant d’un réseau national : Crédit lyonnais, Société générale, Comptoir national d’escompte de Paris et BNCI. L’État a pris en main l’essentiel du crédit. Pendant une vingtaine d’années, les banques nationalisées se sont consacrées à la collecte de l’épargne à court terme, elles ont soutenu les émissions du Trésor tout en participant au financement de la reconstruction et de la modernisation de l’économie. Les banques nationalisées constituaient un secteur stratégique pour l’économie nationale, où on évitait de se faire concurrence. Au delà de la notion de contrôle stratégique en cas de conflit, le maintien dans le giron de l’état de certaines activités économiques répond aussi à la nécessité de « Service Public ». La notion de service public s’entend alors au sens de service destiné au public et donc à tout citoyen, quelle que soit sa position ou sa situation. S’y attache, en plus, une notion républicaine d’égalité de droit. Ainsi, dans cette optique, tout citoyen doit pouvoir, par exemple, disposer de l’énergie électrique à son domicile. Et sans qu’il lui en coûte plus qu’aux autres citoyens même s’il habite dans un lieu très retiré. Ceci implique qu’on installe pour son seul usage, à grands frais évidemment, des kilomètres de ligne. Dans les premiers temps, il en fut bien ainsi. Puis peu à peu, E.D.F. a demandé des contributions pour l’approvisionnement de demeures lointaines, ce qui contrevint à cette logique républicaine d’égalité de droits entre tous les citoyens.
Au delà de la notion de contrôle stratégique en cas de conflit, le maintien dans le giron de l’état de certaines activités économiques répond aussi à la nécessité de « Service Public ». La notion de service public s’entend alors au sens de service destiné au public et donc à tout citoyen, quelle que soit sa position ou sa situation. S’y attache, en plus, une notion républicaine d’égalité de droit. Ainsi, dans cette optique, tout citoyen doit pouvoir, par exemple, disposer de l’énergie électrique à son domicile. Et sans qu’il lui en coûte plus qu’aux autres citoyens même s’il habite dans un lieu très retiré. Ceci implique qu’on installe pour son seul usage, à grands frais évidemment, des kilomètres de ligne. Dans les premiers temps, il en fut bien ainsi. Puis peu à peu, E.D.F. a demandé des contributions pour l’approvisionnement de demeures lointaines, ce qui contrevint à cette logique républicaine d’égalité de droits entre tous les citoyens. Une analyse simpliste conduit souvent à faire croire que la productivité d’une gestion nationalisée est inférieure à celle d’une gestion. Divers exemples montrent le contraire. On ignore souvent que c’est grâce à la recherche, en partenariat avec l’Ecole Nationale des Télécommunications que France Télécom a mis la France en état de passer vite et bien à l’ére numérique. C’est autant grâce à la SNCF qu’à Alsthom que fut créé le TGV, produit industriel modèle et exportable. On ignore souvent que la RATP dispose d’une société qui est intervenue dans la mise en oeuvre de divers métros de par le monde. Et peut-on considérer comme une réussite que tout ce qui reste dans la métallurgie française soit passé entre les mains de la Mittal Steel Company ? Et le coût social du démantèlement de celle-ci en France est-il moins ou plus élevé que les aides qu’on aurait pu apporter à ces industries pour qu’elles subsistent ? Lorsque les autoroutes, en France, ont été construites grâce au péage payés par les usagers, les gouvernants avaient promis qu’une fois amorties, celles-ci reviendraient dans le domaine public. Mensonges: elles ont été vendues. Seul le pont de l’Ile d’Oléron, construit par le département de la Charente Maritime, est devenu gratuit en 1991 une fois amorti.
Une analyse simpliste conduit souvent à faire croire que la productivité d’une gestion nationalisée est inférieure à celle d’une gestion. Divers exemples montrent le contraire. On ignore souvent que c’est grâce à la recherche, en partenariat avec l’Ecole Nationale des Télécommunications que France Télécom a mis la France en état de passer vite et bien à l’ére numérique. C’est autant grâce à la SNCF qu’à Alsthom que fut créé le TGV, produit industriel modèle et exportable. On ignore souvent que la RATP dispose d’une société qui est intervenue dans la mise en oeuvre de divers métros de par le monde. Et peut-on considérer comme une réussite que tout ce qui reste dans la métallurgie française soit passé entre les mains de la Mittal Steel Company ? Et le coût social du démantèlement de celle-ci en France est-il moins ou plus élevé que les aides qu’on aurait pu apporter à ces industries pour qu’elles subsistent ? Lorsque les autoroutes, en France, ont été construites grâce au péage payés par les usagers, les gouvernants avaient promis qu’une fois amorties, celles-ci reviendraient dans le domaine public. Mensonges: elles ont été vendues. Seul le pont de l’Ile d’Oléron, construit par le département de la Charente Maritime, est devenu gratuit en 1991 une fois amorti. Il y a encore des politiques pour vanter les atouts du libéralisme. Après les suppressions massives d’emplois et leurs transferts dans des pays où les gens sont payés au lance-pierre, voici maintenant la face numéro deux: les soit-disant « instruments » financiers qui ne sont, en réalité, que de superbes joujoux qui sont devenus tellement compliqués et alambiqués qu’ils devaient, un jour, péter à la gueule des joueurs. Voilà c’est fait. Et, au nom de la sacro-sainte règle capitaliste de la privatisation des profits et de la mutualisation des pertes, le peuple va être prié, indirectement s’entend, de se serrer la ceinture.
Il y a encore des politiques pour vanter les atouts du libéralisme. Après les suppressions massives d’emplois et leurs transferts dans des pays où les gens sont payés au lance-pierre, voici maintenant la face numéro deux: les soit-disant « instruments » financiers qui ne sont, en réalité, que de superbes joujoux qui sont devenus tellement compliqués et alambiqués qu’ils devaient, un jour, péter à la gueule des joueurs. Voilà c’est fait. Et, au nom de la sacro-sainte règle capitaliste de la privatisation des profits et de la mutualisation des pertes, le peuple va être prié, indirectement s’entend, de se serrer la ceinture.