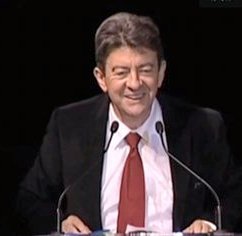Les gouvernements se succèdent mais gardent la même idée pour faire baisser le chômage. L’économiste Philippe Askenazy propose des mesures plus radicales.
Alors que l’emploi reste la priorité des Français, la stratégie de François Hollande exposée pendant la campagne fait débat : le Président-élu entend actionner le même levier que Nicolas Sarkozy, peser sur le « coût du travail ». Autrement dit, jouer sur les cotisations sociales des entreprises.
La solution est appliquée depuis plus de vingt ans en France, sans résultats, fait remarquer Philippe Askenazy. Critique libérale ? Pas vraiment. Le chercheur fait partie des Economistes atterrés, qui « ne se résignent pas à la domination de l’orthodoxie néolibérale », et pensent que « d’autres politiques économiques sont possibles ».
Directeur de recherche au CNRS et docteur à l’EHESS, Philippe Askenazy envisage d’autres solutions pour l’emploi en France.
Rue89 : Quelles sont les spécificités du marché du travail français ?
 Philippe Askenazy : L’état du marché du travail français a beaucoup évolué très récemment. Nous avions auparavant un schéma qui était relativement banal : une situation de chômage enkystée, avec des difficultés pour les jeunes et les seniors. Or, depuis trois ans, des évolutions qui avaient été lentes dans les années 2000 se sont accélérées :
Philippe Askenazy : L’état du marché du travail français a beaucoup évolué très récemment. Nous avions auparavant un schéma qui était relativement banal : une situation de chômage enkystée, avec des difficultés pour les jeunes et les seniors. Or, depuis trois ans, des évolutions qui avaient été lentes dans les années 2000 se sont accélérées :
le taux d’activité des seniors a fortement augmenté. Même quand on regarde la situation des moins qualifiés, ceux qui ont des diplômes en deçà du bac : en trois ans, le taux d’emploi des 55 à 59 ans peu qualifiés a gagné dix points, en pleine crise. Il est aujourd’hui supérieur à celui de l’Allemagne ;
les contrats courts se sont multipliés de façon exponentielle. L’année dernière, neuf millions de CDD de moins d’une semaine ont été signés. Il s’agit principalement de jeunes, embauchés pour un inventaire, un sondage, les soldes, etc. Il ne s’agit pas d’un volant de précaires, mais d’hyperprécaires.
Qu’est-ce qui a permis aux seniors d’être maintenant moins en difficulté sur le marché du travail ?
L’une des difficultés des seniors résidait dans leur manque de qualification. En cause : notre démocratisation scolaire tardive. Or, aujourd’hui, on arrive à des vagues de seniors qui ont des qualifications comparables à celles des autres pays. Du coup, leur taux d’emploi converge avec les moyennes européennes.
L’autre phénomène qui joue, c’est la réforme des retraites. Elle commence à avoir un effet de bâton : les seniors ne démissionnent plus de leur entreprise. Cela vient aussi de la crise.
De leur côté, les employeurs ne savent pas quelle stratégie adopter. D’ailleurs, si vous regardez les entreprises du CAC 40, elles ont pour la plupart changé de DRH ces dernières années.
Elles attendent de savoir à quoi va ressembler l’économie en sortie de crise. Elles attendent également que soient définis des choix sur la transition écologique.
Selon les politiques qui vont être mises en œuvre en Europe, les entreprises vont avoir besoin de parier sur certaines activités plutôt que sur d’autres d’ici deux ou trois ans.
Donc, sur les métiers du cœur de leur activité, les entreprises ne licencient pas les seniors, se disant justement que, dans deux ou trois ans, ils partiront à la retraite. Dans le même temps, elles n’embauchent pas de jeunes, sauf sur des contrats hyper courts.
Peut-on distinguer alors des « insiders », qui durent en entreprise, et des « outsiders », qui n’y entrent jamais définitivement ?
Il existe une dichotomie, certes. Mais nous ne sommes pas dans une situation où il serait trop lourd pour les employeurs de recruter parce que le CDI serait trop rigide. Nous avons été trop loin dans ce type de diagnostic, qui ne regarde que le droit du travail : les types de contrats, le coût du travail, etc. Ce n’est pas une grille de lecture suffisante.
Par exemple, si les employeurs gardent les seniors, ce n’est pas parce que ceux-ci sont protégés par le droit du travail. Ce n’est pas non plus parce qu’un contrat senior a été créé en 2006 pour eux, un CDD de dix-huit mois, renouvelable une fois : le nombre de contrats seniors signés ne dépasse pas une centaine par an. Si les employeurs gardent leurs seniors, c’est parce qu’ils sont en attente [de savoir comment va évoluer la situation, ndlr].
Créer plus de contrats précaires, diminuer le coût du travail, flexibiliser le marché du travail, abolir le smic… On ne devrait plus avoir de chômage depuis vingt ans qu’on applique les mêmes recettes.
Croire que la politique de l’emploi crée de l’emploi, c’est une erreur. Elle joue simplement sur le type d’emplois qui sont offerts aux personnes.
Regardez la Belgique. Le FMI lui a donné les mêmes préconisations qu’à toute l’Europe continentale. Il fallait s’attaquer au salaire minimum. Mais également, pour le pays, désindexer les salaires. Or, la Belgique n’a pas eu de gouvernement pendant trois ans. Donc peu de politiques dites structurelles.
Résultat : le pays a eu, en pleine crise économique, une des meilleures croissance sur ces dernières années au sein de l’Europe. Et elle a atteint son plus faible niveau de chômage des vingt dernières années.
Si vous récusez le principe d’une politique de l’emploi, quels sont les leviers que les responsables politiques doivent actionner ?
Il y a des problématiques de volume d’emplois, qui, elles, renvoient aux politiques industrielles et macroéconomiques, mais également aux politiques de formation, d’éducation, etc :
l’offre d’emploi est créée par les politiques d’éducation, d’immigration, de formation tout au long de la vie, etc. ;
la demande, elle, est créée par la stratégie des entreprises, principalement déterminée par la politique industrielle globale, la politique macroéconomique européenne, qui pèsent bien plus que les contrats de travail.
Les bonnes politiques doivent être tournées vers la création d’activité, les capacités d’innovation, la formation tout au long de la vie. Aujourd’hui, il y a aussi la question de la politique européenne d’austérité. Les priorités sont là.
Où trouver les financements ?
Les politiques centrées autour du coût du travail menées depuis vingt ans coûtent des fortunes. Ce qu’a proposé Hollande ne remet pas en cause cette logique. Or, c’est malheureusement trop inefficace.
L’ensemble de cette politique de l’emploi coûte aux alentours de 35 milliards d’euros tous les ans. J’évalue son efficacité, en termes de création d’emplois, en fonction de toutes les estimations que l’on peut avoir, à la création de 500 000 emplois en France grand maximum. Cela coûte 70 000 euros à l’Etat par tête, pour des emplois souvent peu qualifiés, dont une part à temps partiel.
Tandis que, dans le même temps, on a supprimé des postes de fonctionnaires, au prétexte de faire de réduire la dépense publique. Alors qu’un emploi, s’il était créé directement par l’Etat, lui coûterait 20 000 à 40 000 euros.
Soyons a minima rationnels. Il y a des besoins considérables en matière de sécurité, de santé, d’éducation, de justice. Nous avons besoin d’agents publics dans un pays où la population croîtra de près de deux millions sur le quinquennat.
De manière générale, les politiques de création directes d’emplois doivent être réhabilitées. Et une vraie politique industrielle. Là aussi, on a toute une série de dispositifs fiscaux pour les entreprises. Ils vont principalement aux grandes entreprises, qui ne sont absolument pas génératrices d’activité en France. Elles n’y génèrent que des profits.
Je ne dis pas qu’il faut creuser nos déficits publics. Je dis qu’il y a de l’ordre de 20 milliards de politique de l’emploi à pertes. Et 30 milliards de politique fiscale sur les entreprises qui ne font que gonfler leurs profits. Avec 50 milliards, on peut faire beaucoup de choses.
Quelle politique d’éducation mener, par exemple ?
Il faut casser une politique suicidaire européenne. Regardons les Etats-Unis, où la politique d’austérité est peu présente. Pour limiter le chômage des jeunes, une vraie politique de poursuite des études a été mise en place.
Ce n’est pas le cas en Europe. Ici, on dit aux jeunes qu’ils auront de toute façon des difficultés, donc autant aller directement sur le marché du travail. En France, le taux de poursuite des études après le bac est aujourd’hui de 70%, contre 85% en 1993. En Europe, on ne met plus d’argent dans les universités. Nous bradons notre futur.
Il faut investir dans la poursuite des études. Les engagements relayés par Vincent Peillon suggèrent qu’il y a là conscience de cet enjeu chez le Président élu.
Et quelle politique industrielle ?
Le renouvellement de notre tissu productif est insuffisant. Et nos entreprises n’arrivent pas à trouver de financements. Nos banques sont parmi les plus puissantes en Europe, mais elles sont extrêmement frileuses. Elles ne soutiennent pas les PME.
Que fait l’Etat ? Oséo, entreprise publique qui se définit comme la banque des PME, ne fait que des cofinancements : elle ne finance une entreprise que si celle-ci a reçu un financement privé, bancaire. Comme ce financement privé est déficient, le financement public l’est aussi. Mieux vaudrait partir du constat que l’apport privé est déficient et avoir une politique industrielle de financement des PME à la hauteur. Là-aussi, ce diagnostic semble posé par Alain Rousset [responsable du pôle industriel au sein de l’équipe Hollande, ndlr].
Plus largement, quelles sont les activités qu’il faudrait encourager ?
Nous allons aborder une transition écologique, et il va falloir faire des choix. Ce qui est sûr, c’est que les besoins de santé vont augmenter en Europe. Non pas tant en lien avec le vieillissement de la population, mais avec les prochaines vagues de progrès technologiques. Et la France est bien placée dans le domaine.
Il existe déjà une forme de mobilité pour ça. Le retraité britannique qui vient s’installer en France le fait aussi pour bénéficier de notre système de santé. C’est refacturé en Grande-Bretagne – système de compensation européen –, donc c’est de l’argent qui entre en France. Et il n’y a pas de raison de valoriser plus la production automobile que la pose de prothèses de hanches. Qu’une personne puisse marcher convenablement à pied ou rouler en automobile, je ne vois pas pourquoi d’un côté, ce serait un coût, et de l’autre, de la production.
Le segment éducatif supérieur pourrait être l’autre pilier de notre développement. La mondialisation est aussi une évidence sur ce plan-là. Nous pourrions avoir une vraie politique d’accueil de la jeunesse mondiale en France.
Elsa Fayner. Rue89. 11 mai 2012
Reproduit sans autorisation conformément aux usages implicites du web
Notes d’économe politique 75 – 12 mai 2012