On dit que j’ai échoué en Lettres Modernes. Point du tout. Ce sont les Lettres Modernes qui ont échoué. J’étais là, plein de disponibilité et de ferveur, disposé à analyser le moindre petit pied de la Légende des Siècles. Et voici qu’il me fallut me colleter avec le Lai de Lanval. Et d’ailleurs, qui sait aujourd’hui ce qu’est un « lai » et « de Lanval » de surcroiît ?
Je m’inscrivis donc en Psychologie et pour la première année, au Certificat de Psychologie Générale qui était commun avec la Licence de Philosophie et au Certificat de Psychologie de l’Enfant qui était spécifique.
Et voici que mon père, conseillé par je ne sais qui, m’apporta deux livres qu’il avait emprunté à la Bibliothèque des Cheminots de Paris Austerlitz, à lire avant la rentrée (qui à cette époque heureuse avait lieu début novembre): L’Introduction à la Psychanalyse de Sigmund Freud et le Traité de Psychologie de Norman L. Munn (ou plutôt la traduction en français de ce manuel américain). J’y découvris deux univers très différents. Sans doute Freud fut-il celui qui m’étonna le moins, car on m’avait, bien sûr, déjà parlé de Psychanalyse. Mais je fus quand même frappé par la prudence de l’auteur. Car Freud, comme dans beaucoup d’autres ouvrages, se montre hésitant. Il utilise des circonlocutions, des métaphores. Ou, plutôt, expose bien la différence entre les faits de parole de ses clients sur le divan et les hypothèses explicatives qu’il construit. C’était une vraie leçon d’humilité. L’inventeur de la Psychanalyse faisait part de ses hésitations, voire de ses incertitudes. Je dois dire que j’ai souvent regretté, par la suite, que ses successeurs connaissent moins l’usage du conditionnel. En particulier Mélanie Klein que j’ai toujours considérée comme une cinglée quand elle nous parle de « fantasme de dévoration du sein maternel ». René Zazzo l’a clouée en palant des « vaticinations de Dame Mélanie Klein ». Même si j’ai une dent contre Zazzo pour son attitude lors de ma thèse, j’incline à penser comme lui.
Quant à Munn, ce fut une découverte. Tous ces rats qu’on faisait souffrir et toutes ces expériences… Découverte ! Car, en fait de Traité de Psychologie, celui de Munn était un Traité de Psychologie Expérimentale. Mais je survécus et j’appris quelque chose: c’est qu’il existait bien des voies d’études du psychisme et que rien ne pouvait prouver que l’une était meilleure que l’autre tant que les auteurs se gardaient de confondre les hypothèses et les conclusions. Cette attitude, dont je découvris par la suite qu’elle était scientifique, ne m’a jamais quitté. Cela m’a valu l’inimitié de certains psychanalystes. Les expérimentalistes sont plus sereins.
Cette première année de psychologie fut très heureuse. J’y rencontrais une jeune personne avec qui j’allais partager quelques mois de ma vie. Ce ne fut pas sans incidence sur mes choix car elle était encore en cure psychanalytique. Fut-ce l’effet de cette compagnie ? Je m’ennuyais assez peu en cours. Il y avait même des intervenants brillants comme Pierre Gréco, un bon élève de Piaget (mais j’avoue que je ne comprenais pas tout). Gréco maîtrisait totalement les concepts piagetiens. Mais nous, pauvre auditoire. Mais c’était brillant. Que dis-je brillant, suprême. Le privilège rare d’écouter un prof qui parle sans notes et sans ennui. A la fin, on apllaudissait à tout rompre.
Il y eut Daniel Lagache, le samedi matin à 8 heures dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Pourquoi cette admiration ? L’horaire et le jour étaient difficiles et je ne me souviens pas qu’il fut un grand orateur. Et il faisait un cours sur le « Deuil Pathologique », pas de quoi danser la java ou le rock ! Et cette détresse lorsque je compris qu’il nous parlait d’une de ses patientes qui s’étaient immolée par le feu. Et là j’ai approché toute la solitude et la grandeur du thérapeute dans la souffrance qu’il s’autorisait à laisser percevoir à ses élèves. Et il nous apprenait aussi combien notre expérience et notre savoir étaient bien peu de choses… Et, en même temps, par son expérience même, il nous apprenait aussi le droit à l’erreur.
Daniel Lagache fut de ceux qui comprirent très tôt que, malgré les diverses méthodes d’approche, la Psychologie, en tant qu’elle s’efforcer d’expliquer le fonctionnement de l’être humain, était une et indivisible. Beaucoup des petits maîtres qui lui ont succédé, l’on oublié.
Dans la catégorie monstres sacrés, il y eut aussi Paul Fraisse. Pourtant pas un brillant enseignant. Ni même un brillant chercheur. Au jour d’aujourd’hui, il serait classé en troisième ou quatrième ligne.
Je crois bien qu’il faisait un cours sur l’apprentissage. Un cours de Psychologie Expérimentale. Pas vraiment marrant. Mais il y avait quelque chose que j’ai compris plus tard, quand j’ai su qu’il était très croyant, tout l’humanisme qui l’animait derrière les expériences de laboratoire qu’il nous exposait sans jamais perdre l’homme de vue. Un expérimentaliste comme lui ne pouvait être totalement sec.
J’ai eu l’immense terreur et l’immense privilège d’être interrogé par Paul Fraisse à l’oral. J’ai survécu. Je crois bien, même, avoir obtenu une note honorable.
A un an près, j’aurais pu entendre Jean Piaget. Mais il avait regagné Genève. Pierre Oléron lui avait succédé.
Oléron était un enseignant épouvantable. Les applaudissements, à la fin de chaque cours, étaient misérables. J’ai su, par la suite qu’il détestait faire des cours. Il était parvenu à la chaire de Psychologie Génétique, à la suite de Piaget, apparemment comme troisième homme dans une situation où des considérations politiques et diverses ne permettaient pas de faire un choix. Je sais que René Zazzo était l’un des postulants. Je ne sais plus qui était l’autre, peut-être Merleau-Ponty. En tous cas, Zazzo était de gauche, communiste, disait-on. Et en ces temps-là ce n’était pas un avantage hors des territoires culturels dominés par le Parti.
Je reparlerai plus tard de Pierre Oléron, parce que je devais le cotoyer de nombreuses années.
J’eus aussi le privilège de suivre les enseignements de Maurice Debesse. L’homme était très âgé, avait probablement dépassé l’âge de la retraite. Il mérite cependant un mot pour avoir cristallisé la recherche pédagogique de l’époque. Aujourd’hui, on a tendance à se tordre de rire en lisant ce qu’il a écrit sur la Crise d’Originalité Juvénile. Pour l’époque puritaine et gaullienne, c’était quelque chose. Je crois que Debesse et la plupart des enseignants de Pédagogie, appartenaient à des mouvements d’Education Nouvelle. J’en étais aussi quelque peu, ayant préparé mon Diplôme de Moniteur de Colonies de Vacances (eh oui ! c’était le nom) avec les C.E.M.E.A. qui étaient un repaire de gauche dans lequel je m’étais bien repéré.
Et puis il y avait Juliette Favez-Boutonnier. Je n’en parle pas pour ses cours de psychanalyse qui n’avaient pas le charisme de ceux de Lagache. Non, mais après son cours, nous nous retrouvions à quatre, dans un café, avec Josiane Delhemmes, Annick Guérin et Viviane Hazan pour réunir et mettre en ordre nos notes pour le Bulletin de Psychologie.
© Jean Pierre Dufoyer, novembre 2008



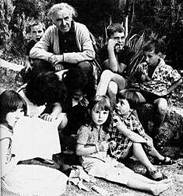 Je ne suis pas allé voir Entre les murs. Pire, je n’ai pas envie d’y aller. Au moins pour l’instant. Pourquoi ?
Je ne suis pas allé voir Entre les murs. Pire, je n’ai pas envie d’y aller. Au moins pour l’instant. Pourquoi ?
