
Cet article est paru sur Médiapart le 10 octobre 2010. Il n’est pas accessible aux non abonnés (http://www.mediapart.fr/journal/france/201010/lheure-du-peuple). Mais je juge que cette analyse appartient désormais à l’histoire. Qu’Edwy Plenet et Médiapart me pardonnent alors cette entorse au respect du droit d’auteur.
Où va la France ? Nul ne le sait, et les journalistes pas plus que les acteurs de l’actuel mouvement social. C’est une histoire non écrite qui s’invente au jour le jour, de rendez-vous en rendez-vous, de manifestations en grèves. Le pays se sent confusément au seuil de l’imprévu et de l’inattendu, pour le meilleur ou pour le pire, entre extension et reflux, surprise, accident ou épuisement. Depuis les premiers défilés du 4 et du 7 septembre, chacun sent bien que nous vivons l’un de ces moments où le peuple, dans sa diversité d’âge et de condition, entend faire valoir ses droits légitimes contre une légalité illusoire.
La démocratie est de son côté, sur l’asphalte des rues, dans les établissements scolaires ou dans les lieux de travail. Car la démocratie véritable suppose sa présence active. Elle n’est pas ce silence forcé auquel on voudrait le contraindre cinq ans durant, en le laissant seulement choisir, d’élection en élection présidentielle, un maître intouchable avant de l’obliger à retourner en servitude. En tentant de dérégler l’agenda que voudrait lui imposer autoritairement le pouvoir, le peuple défend donc bien plus que ses droits acquis. Il dit, tout simplement, qu’on ne décide pas de son sort sans le consulter. Qu’on ne modifie pas ses conditions de vie sans l’écouter. Qu’on ne lui impose pas des priorités dont il ne veut pas.
C’est ainsi toute la société qui gronde, consciente de l’enjeu symbolique de la bataille des retraites. Sera-t-elle abaissée et humiliée par un pouvoir arrogant qui diffuse peur et défiance, insécurités et divisions, pour mieux imposer les intérêts d’une minorité oligarchique ? Ou bien sera-t-elle relevée et rehaussée par sa propre volonté rassemblée, retrouvant confiance en elle-même afin d’imposer les exigences du plus grand nombre contre les privilèges de quelques-uns ? Deux interrogations qui n’excluent pas un troisième scénario : une société apparemment défaite mais secrètement victorieuse, offrant à ce pouvoir aveugle une victoire à la Pyrrhus tandis qu’elle entrerait durablement et profondément en dissidence, patiemment et paisiblement réfractaire.
Entre ces incertitudes, c’est le temps qui fera la décision. Non pas le temps comme durée ou impatience, mais le temps comme maîtrise et exigence. Trois temporalités s’affrontent ici.
Celle du pouvoir d’aujourd’hui, cette hyperprésidence césariste dont le temps est celui de l’urgence : que sa volonté passe, à tout prix, au plus vite, fût-ce en force et avec violence.
Celle du pouvoir de remplacement, cette opposition socialiste dont le temps est celui de l’attente : que rendez-vous soit pris avec elle pour 2012, sans précipitation ni radicalisation, en lui faisant crédit sans compter.
Celle, enfin, de ce peuple qui manifeste et proteste avec constance, dont le temps est plus essentiellement celui de la vie, de la vie vécue, de la vie sensible, de la vie partagée : que ses vies concrètes, au travail, à l’école et en famille, entre générations, entre voisins et entre collègues, soient défendues, protégées et améliorées ici et maintenant. Ce peuple-là sait bien qu’il ne doit compter que sur lui-même : ce qu’il réussira à prendre ou à sauver le garantira bien plus que des promesses lointaines et, d’expérience vécue, souvent illusoires.
Le temps des manifestations contre l’agenda de Mrs Tina
Nul hasard évidemment si cette citation se trouve en exergue du livre récent des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Le Président des riches (Zones, 2010). Nul hasard non plus si, au tout début de la présidence de Nicolas Sarkozy, l’un des porte-voix du patronat, Denis Kessler, doté d’un franc cynisme, lâchait un aveu semblable, créditant le nouveau régime de vouloir « défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance » et, au fond, prendre ainsi une revanche historique sur le Front populaire de 1936 dont les idéaux inaccomplis inspirèrent nombre des réformes de 1945. Nul hasard enfin si, dans un lapsus à répétition, le patron des députés UMP, Jean-François Copé, a régulièrement exprimé sa crainte d’une France saisie par « une tentation de la nuit du 4 août dont il faut se débarrasser » (en 2009), voire d’une « ambiance malsaine de nuit du 4 août » (en juin 2010). Oui, cette nuit du 4 août 1789 qui pourtant marque le début de la fin de l’Ancien Régime avec l’abolition des privilèges. Ils ne se cachent donc pas de craindre pour leurs privilèges. Et s’ils ont peur du peuple, c’est parce qu’il n’est pas dupe de leurs intentions.
Car, toutes générations confondues, il sait que l’affaire des retraites n’est pas une question comptable mais un enjeu de société. En prétendant, contre toute rationalité économique, qu’il n’y aurait qu’une seule solution pour préserver les pensions, celle de contraindre les salariés à travailler et à cotiser plus longtemps, le pouvoir n’entend pas défendre nos retraites mais attaquer nos sécurités. MicrosoftInternetExplorer4 –> Comme la lettre volée de la nouvelle d’Edgar Poe, placée en évidence sur la cheminée, la vérité de la situation n’échappe qu’à ceux qui se laissent aveugler. Et c’est bien là le message du mouvement social : ne plus se laisser avoir, ne plus se laisser faire, ne plus se laisser tromper. D’où cette méfiance récurrente envers les médias dominants, au risque de confondre les journalistes avec leurs employeurs, tant leur responsabilité est grande dans ce moment particulier. Car ils ont le pouvoir de nommer les choses et, par conséquent, de nous tromper en les parant d’atours mensongers, très loin du réel et tout près de l’idéologie. Réforme ou contre-réforme ? Discours sécuritaire ou propos incendiaires ? Identité nationale ou pédagogie xénophobe ? Dans la filiation de George Orwell, l’auteur de 1984 qui avait démasqué la novlangue des dominations modernes, le collectif « Les mots sont importants » met en garde, à juste titre, contre ces lieux communs du langage médiatique où se donne à voir une « euphémisation de la violence des dominants » associée à une « hyperbolisation de la violence des dominé-e-s ».
« L’euphémisation consiste, étymologiquement, à positiver du négatif, rappellent ses initiateurs, Sylvie Tissot et Pierre Tevanian. Dans la sphère politique, elle consiste à essentiellement occulter, minimiser, relativiser et justifier une violence » (Les mots sont importants 2000-2010, Libertalia, 2010). Ainsi ne parlera-t-on que de réforme, de modernisation, d’assouplissement, etc., quand le droit du travail est affaibli, la protection sociale réduite et tel service public privatisé. A l’inverse, la révolte de ceux qui subissent ces mesures sera qualifiée de conservatisme, de corporatisme et de crispation, voire de provocation.
Les éditoriaux des médias dominants sont actuellement encombrés de ces raisonnements automatiques qui font fi des expertises syndicales ou associatives, vulgate dont le dernier exemple en date fut offert par l’actuel directeur du Monde. « There is no alternative », avait l’habitude de dire Margaret Thatcher pour justifier sa contre-réforme néo-libérale, ce qui lui valut chez ses opposants le surnom de Mrs Tina. Il n’y a pas d’autre solution, ne cessent de répéter après elle ses équivalents français, adhérents tacites de ce «cercle de la raison» qui unit droite et gauche supposées gestionnaires… dans leur irrationalité et leur irresponsabilité.–
La priorité à l’emploi contre la diversion des retraites
Car, entre-temps, une démonstration cinglante est survenue avec cette troisième crise historique du capitalisme dont nous sommes loin d’être sortis, aussi ample et profonde que celles de 1857 et de 1929. Le bilan de ces politiques sans alternative, ou plutôt niant toute alternative, est là : des richesses dilapidées, des inégalités accrues, un chômage en hausse, des sociétés affaiblies, des peuples inquiets, des pays désindustrialisés, des économies fragilisées, etc. Au grand dam des excellents « économistes atterrés », qui refusent de tourner la page de cette démonstration radicale toujours inaudible dans les discours dominants, Mrs Tina est donc de retour, en version tricolore. Elle l’est en fait depuis le début de ce feuilleton des retraites, depuis qu’au printemps dernier, le piège d’un agenda présidentiel aussi soudain qu’impatient s’est refermé sur des directions syndicales trop consentantes et sur une opposition socialiste trop complaisante.
En effet, en quoi les retraites étaient-elles l’urgence du moment ? Pourquoi fallait-il, toutes autres affaires cessantes, sur un dossier si complexe, trancher si vite, dans un calendrier si serré qui présageait de l’humiliation finale du Parlement via la censure de fait de l’opposition ? Comment en est-on venu à imposer à tout un pays de débattre d’un futur incertain – le fameux « trou » des retraites – sans aucunement discuter d’un présent évident – le chômage et la crise ?
Ce que la protestation actuelle s’efforce de nous faire comprendre, c’est que l’agenda présidentiel des retraites était en lui-même un piège. D’emblée, la méthode choisie fut celle de la revanche symbolique contre les syndicats et la gauche, plutôt que celle d’une recherche du compromis ou du consensus. Dans ses procédés (ce calendrier en forme de déclaration de guerre), comme dans ses objectifs (cet isolement d’un dossier pourtant indissociable de celui de l’emploi), cette offensive tenait du calcul partisan plutôt que de la responsabilité politique.
Car ce sont bien les emplois qui font les retraites et ce sont bien les actifs qui financent les pensions. Comment cette évidence a-t-elle pu disparaître à ce point du débat public alors que la France connaît un taux de non-emploi des moins de 25 ans qui bat des records en Europe ? Pourquoi ne pas avoir fait des mesures pour l’emploi des jeunes un préalable à toute discussion sur l’avenir des retraites ? Autrement dit, ce que rappelle le mouvement social aux directions syndicales comme à l’opposition parlementaire, c’est que, pour porter une alternative crédible, il faut d’abord être capable de promouvoir un agenda différent de celui du pouvoir, d’imposer dans la société un raisonnement qui ne soit pas pris au piège des préjugés gouvernementaux.
Aujourd’hui, l’emploi devrait être la question centrale d’une République authentiquement sociale. Le nombre des inscrits au Pôle emploi a augmenté de 1,1 million entre juillet 2008 et juillet 2010. Avec 4,6 millions d’inscrits, soit un actif sur six, le record enregistré il y a treize ans, en 1997, est battu. Les inscrits au Pôle emploi qui n’ont pas travaillé du tout étaient 2,7 millions en juillet dernier, soit un actif sur dix. Quant au nombre de chômeurs de longue durée, il ne cesse de croître, atteignant plus de 1,4 million, soit un actif sur vingt. Les plus touchés sont les ouvriers, mais les employés ont vu leur nombre de chômeurs augmenter d’un quart en deux ans, tandis que les jeunes de 15 à 24 ans sont évidemment les premières victimes de la crise.
A cette priorité de l’emploi, que l’offensive sur les retraites avait pour objet de reléguer au second plan, s’ajoute la question de la répartition des richesses, spectaculairement illustrée par l’affaire Bettencourt, durant l’été. Liliane Bettencourt gagne 550 euros par minute sans rien faire tandis que la moitié des salariés du pays gagnent moins de 1500 euros par mois. Toute la machinerie idéologique mise en œuvre voudrait faire porter aux travailleurs la responsabilité des déficits publics et, ainsi, évacuer toute interrogation sur une politique immensément favorable, depuis dix ans, aux plus fortunés. Tandis que le poids des dépenses publiques dans le PIB français restait stable (de 52% en 1985 à 53% en 2008), en revanche les politiques de réduction d’impôt mises en œuvre n’ont cessé d’appauvrir l’Etat, dans des montants astronomiques confirmés par le député UMP Gilles Carrez et détaillés par Mediapart.
Tandis qu’ainsi, certains s’enrichissent en dormant, sans faire grossir la richesse collective, le travail des Français restait parmi l’un des plus productifs au monde en 2009, seulement devancé par l’Irlande et le Danemark, comme le rappelle le dossier d’octobre d’Alternatives économiques, consacré à juste titre au chômage. Selon les calculs du mensuel, chaque Français qui occupe un emploi a produit l’an dernier 5% de richesses de plus qu’un Américain, 19% de plus qu’un Italien, 21% de plus qu’un Allemand et 28% de plus qu’un Britannique. La France cumule donc ce paradoxe d’être à la fois l’un des pays où ceux qui ont un emploi produisent le plus de richesses et où le nombre de demandeurs d’emploi est le plus élevé. C’est aussi, contrairement aux fredaines officielles, l’un des pays fiscalement les plus favorables aux plus fortunés dont le taux d’épargne est un des plus élevés au monde.
Notre droit à avoir des droits contre leurs privilèges
Partage des richesses, partage du travail, relance plutôt qu’austérité, confiance au lieu de défiance, solidarité contre inégalité : les quelques données ci-dessus rappelées suffisent à indiquer d’autres priorités, d’autres raisonnements,
d’autres solutions que celles aujourd’hui imposées au pays par le pouvoir. Dans un ouvrage très pédagogique, L’Enjeu des retraites (La Dispute, 2010), le chercheur Bernard Friot les détaille minutieusement, déconstruisant avec méthode tout l’argumentaire des prétendus réformateurs.
« Pourquoi ne sauve-t-on pas les retraites de la même manière qu’on a sauvé les banques ? demande-t-il ingénument. On vient de sauver les banques en leur donnant de l’argent, beaucoup d’argent d’ailleurs, tandis que, pour « sauver » les retraites, depuis vingt ans, on ne fait que leur ôter de l’argent, principalement par le gel du taux des cotisations patronales. N’est-ce pas étrange ? (…) Sauver par la saignée : Molière nous a appris à nous méfier de ces dangereux médecins et de leurs prétendus remèdes. D’autant plus qu’il y a trente ans que cette thérapeutique dure et que nous voyons bien que ces sauvetages ne sauvent que les actionnaires. »
Ce livre met à nu l’irrationalité de la réforme et, surtout, combien elle fait l’impasse sur les retraités eux-mêmes, leur rôle dans la société, leur contribution à la solidarité, leur rapport au travail. Sur Mediapart, Mathieu Magnaudeix a tôt détaillé les cinq grandes injustices d’une réforme qui taxe beaucoup le travail, très peu le capital ; qui occulte les inégalités d’espérances de vie ; qui pénalise les femmes et les plus modestes ; qui risque d’aggraver les conditions de travail ; et qui, enfin, fait un tri arbitraire entre les pénibilités.
Il faut sans doute y ajouter le déni de la retraite elle-même comme réussite sociale, épanouissement d’activités choisies, occasion d’entraides inter-générationnelles, invention d’une seconde vie libérée d’anciennes servitudes et contraintes, don à la collectivité de son temps libre, engagement dans le tissu associatif, etc.
On prête à la ministre de l’économie, Christine Lagarde, ce cri du cœur pour justifier l’obligation de rechercher un emploi faite désormais aux chômeurs de plus de 57 ans : « Mais, enfin, on n’est pas fichu à 57 ans ! » Comme s’il fallait être fichu, abîmé, blessé, épuisé, pas loin du cercueil, etc., pour avoir droit à la retraite et, ainsi, bénéficier de cette seconde vie qui, l’allongement de l’espérance de vie aidant, ne signifie aucunement un retrait de la société ! Sans doute inconsciente, cette morgue sociale exprime l’impensé profond de l’offensive gouvernementale : en culpabilisant ainsi ceux qui n’ont d’autre richesse que leur travail, une vie de travail dont la retraite est l’une des récompenses, c’est en fait notre droit d’avoir des droits que met en cause ce pouvoir.
Sa contre-réforme tourne le dos à la philosophie du « droit naturel » qui, depuis le dix-huitième siècle, a nourri l’espérance démocratique et sociale : cette idée que l’homme a naturellement des droits, tout simplement parce qu’il est homme et que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » (Article 1 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789). Des droits donc, droit au travail, droit à la santé, droit à l’éducation, droit au repos, droit au logement, droit à la libre circulation, droit d’expression et d’opinion, etc. Des droits naturels, pas des droits conditionnels.
Dans la diversité de ses situations, le peuple qui s’ébranle a compris cet enjeu. On se tromperait en effet et, notamment, l’on ne comprendrait rien à l’irruption de cet acteur improbable qu’est le mouvement lycéen, si l’on voulait réduire l’actuelle protestation dont les retraites sont le point de ralliement à cette seule question. C’est une protestation bien plus vaste et profonde qui s’exprime, venue de tous les secteurs touchés par les dégâts des régressions en cours : non seulement l’éducation, mais aussi la santé, la justice, l’habitat, les territoires, l’immigration, les services publics, le transport, les équipements collectifs, etc. Partout, les revendications sont latentes tant les conditions de travail se sont dégradées. Partout, des colères rentrées cherchent l’occasion de s’affirmer. Partout, des humiliations accumulées espèrent leur revanche.
Le temps de la démocratie contre le présidentialisme
Pour l’opposition socialiste, qui prétend succéder à ce pouvoir d’ici un an et demi, ce paysage devrait être réjouissant. Or, loin de se saisir de cette opportunité, on sent la majorité du Parti socialiste prudente, voire méfiante. Certes, elle accompagne le mouvement, mais s’abrite derrière les directions syndicales alors même qu’elles sont elles-mêmes impuissantes à faire céder le pouvoir et à trouver une issue à la crise. Laissant les mobilisations se succéder sans chercher à leur offrir une perspective politique, le PS s’est empressé de mettre en garde contre la radicalisation et, à la vérité, renvoie le présent au futur : l’élection présidentielle de 2012.
Son attentisme est à la fois de conviction et d’opportunité : parti d’élus et non plus de masse, il s’alarme spontanément au spectacle de la rue manifestante, dans la mesure où elle est imprévisible et incontrôlable ; parti converti au présidentialisme bonapartiste, il a renvoyé à ses « primaires » de l’été 2011 l’arbitrage de ses compétitions internes.
En d’autres termes, tout cela vient trop tôt et il n’est pas encore prêt. A tel point que sa première secrétaire se comporte plus en syndic de la diversité socialiste qu’en leader d’une opposition de gauche rassemblée. A tel point, de plus, qu’au bout de trois ans et demi de présidence sarkozyste, cet inévitable parti central ou charnière de la gauche qu’est le PS n’a jamais cherché à réunir ou organiser un front commun unitaire des oppositions politiques.
Le PS prend ainsi le risque de se comporter avec une mentalité de propriétaire, comme si le pouvoir allait lui revenir naturellement sans qu’il fasse d’effort sur lui-même et auprès de la société. Il attend, et espère que le peuple voudra bien attendre avec lui, au point de lui demander d’arbitrer ses rivalités intestines en ouvrant largement le collège électoral du choix de son candidat. Mais c’est un pari discutable de croire que ledit peuple n’a pas de mémoire. De mémoire immédiate, d’abord : le moment venu, il se souviendra de ceux qui se seront vraiment opposés, sans relâche ni compromis, sans hésitations ni précautions, à cette hyperprésidence. De mémoire longue, ensuite : d’instinct, il sait bien que cette exacerbation de la crise démocratique française dont le sarkozysme est à la fois l’instrument et le produit a une histoire, dont les gouvernants socialistes d’hier sont aussi comptables. Bref, le peuple n’est pas incapable de faire lui-même l’inventaire, et notamment parmi ceux qui, justement, n’auront pas fait leur propre travail d’inventaire.
L’aile gauche du PS n’est certes pas insensible à ces arguments, et l’on sent qu’elle tente, ces jours-ci, d’ébranler sa lourde machine partisane. A l’opposé, le discours le plus symptomatique du conservatisme socialiste est aujourd’hui tenu par François Hollande qui, en ces temps de protestation sociale, a bizarrement fait de l’anti-sarkozysme sa cible politique favorite. L’ancien premier secrétaire du PS lors des deux dernières défaites présidentielles, celles de 2002 et de 2007, n’a de cesse de fustiger cette « paresse » ou cette « facilité » que serait l’anti-sarkozysme, posture, ajoutait-il le 26 septembre sur RTL, « à la portée du premier venu ».
Pourtant, c’est ne pas voir, ou plutôt se refuser à voir, que l’anti-sarkozysme populaire n’est pas une négation, mais une exigence. Que, loin d’exprimer seulement un refus, il affirme le désir de réponses radicalement nouvelles, et non plus la répétition de recettes éculées. La critique active, par la société elle-même, de cette présidence met la barre haut, qu’il s’agisse des pratiques démocratiques (un présidentialisme sans contrôle), des questions sociales (une politique de classe) ou des sujets internationaux (le refus du monde).
Or, à l’exception des questions fiscales dont François Hollande est un spécialiste indéniable, on attend toujours, dans ces trois domaines, les propositions concrètes des socialistes marquant une véritable rupture avec non seulement ce que nous subissons depuis 2007, mais aussi avec ce que nous avons vécu depuis que le PS revendique « une culture de gouvernement » qui, dans les faits, a souvent signifié sinon sa conversion à l’ordre existant, du moins son accommodement ou son arrangement avec le monde tel qu’il va, injuste et inégal.
Grand corps sans tête, le mouvement social actuel est confusément animé par l’espoir d’une opposition déterminée, témoignant d’une altérité véritable avec l’oligarchie sociale qui, aujourd’hui, prétend régenter notre République. Car ce que nous donne à voir cette présidence, dans toutes ses pratiques comme dans tous les domaines, c’est la confiscation du bien commun par une minorité qui, au croisement des mondes financiers et politiques, se croit au-dessus du peuple, plus compétente que lui, plus experte et plus clairvoyante, plus à même de choisir à sa place son avenir et de le conduire là où, sans doute, il ne voudrait pas aller. S’ils ont peur du peuple, c’est parce qu’au fond, ils n’aiment pas la démocratie, ce régime où n’importe qui peut prétendre s’exprimer, voter, se faire élire, voire gouverner, sans privilège de fortune, de naissance ou de diplôme. Tel est le scandale démocratique qu’ils veulent conjurer, en instituant durablement les nouveaux privilèges d’une oligarchie de la possession, de l’avoir et du pouvoir.
L’heure du peuple, c’est donc le temps de la démocratie. D’une démocratie vivante et réjouissante, inventive et curieuse, égalitaire et solidaire. D’une démocratie qui n’attend pas.




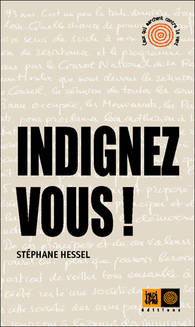
 Dans le langage des campagnes, on dit une « moissbat ». Une moissonneuse batteuse se déplace sur le champ de céréales, coupe, plie, écrase, et restitue le grain d’un côté et la paille de l’autre.
Dans le langage des campagnes, on dit une « moissbat ». Une moissonneuse batteuse se déplace sur le champ de céréales, coupe, plie, écrase, et restitue le grain d’un côté et la paille de l’autre.
 Le point de doctrine qui fait toute la différence avec les autres est sa rupture avec l’économie de marché.
Le point de doctrine qui fait toute la différence avec les autres est sa rupture avec l’économie de marché.
